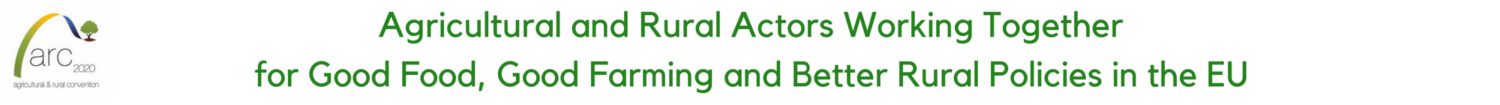Samedi le 25 février, le Salon de l’Agriculture démarre à Paris : Au-dessous un maquillage de paysannerie idéalisée, aucun signe de changement chez l’industrie agro-alimentaire. Tout comme pour la nouvelle PAC, qui maintient les pratiques agricoles non durables tout en affaiblissant la cohésion européenne. « L’agriculture du carbone », avancée comme voie vertueuse, ne changera rien sur le fond. C’est trop peu, trop tard, insiste Hannes Lorenzen, président de l’association ARC2020, lors d’une tribune pour Le Monde.
Read this article in English
La Politique agricole commune (PAC) entrée en vigueur en janvier dernier est un dinosaure. Elle maintient des pratiques de production non durables face aux défis du climat et de la biodiversité et affaiblit la cohésion européenne. La Commission européenne a commis des erreurs stratégiques au cours des dernières années. Elle a renationalisé la PAC, au lieu de renforcer sa dimension de pilier de l’intégration européenne et de transformation agroécologique. Elle a cédé aux pressions des États membres en faveur de règles moins communes et de restrictions agro-environnementales peu ambitieuses. Elle a accepté que cette PAC ne soit pas soumise aux ambitions écologiques du Pacte Vert qui fait déjà trop peu, trop tard. En regard de l’impact climatique et environnemental de l’agriculture, c’est une aberration. À croire que personne, à Bruxelles, n’a lu le rapport du GIEC sur l’usage des terres.
Cette PAC sape les engagements en matière de climat et de biodiversité de l’accord de Paris. Si elle reste inchangée, basée sur des subventions pour les combustibles fossiles, les engrais chimiques et les pesticides, si le Pacte Vert ne transforme pas l’utilisation extractive des terres en un système agricole et alimentaire écologiquement soutenable avant 2027, l’accord de Paris perdra sa pertinence et la souveraineté alimentaire européenne sera menacée.
L’UE est structurellement très dépendante des importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de pays tiers dont les systèmes de production ne sont pas durables et pour certains esclavagistes. Parallèlement, l’UE subventionne ses exportations vers les pays émergents et en développement avec un effet de déstabilisation des marchés et d’insécurité alimentaire.
La guerre en Ukraine a révélé cette dépendance avec l’emballement du prix des céréales et de l’huile de tournesol. Les céréales qui ont quitté l’Ukraine ont d’abord été acheminées vers les sites de production de viande européens avant d’être fournies aux régions souffrant de la faim. Sous pression du lobby agro-industriel, notamment le Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne (COPA) présidé par Mme Christiane Lambert, le réflexe politique des ministres de l’agriculture de l’UE a été de faucher les quelques tentatives d’écologisation comme la rotation des cultures et l’abandon des jachères qui sont désormais labourables. Un non-sens agronomique, écologique et climatique.
Si ce lobby continue de bloquer avec succès toute tentative concrète de la Commission européenne de faire fonctionner un Pacte Vert dans la pratique, ce qui reste de PAC risque d’être annexé aux politiques de cohésion nationales ou régionales sans dimension spécifique agricole ou rurale. Dans cette configuration, contraints par les réalités géopolitiques, si l’Ukraine et les Balkans occidentaux rejoignent l’UE comme promis, il en sera fini de la PAC comme pilier de l’intégration européenne.
La Commission et l’agro-industrie avancent « l’agriculture du carbone » comme voie vertueuse de contribution de l’agriculture à la limitation de l’effet de serre. Il s’agirait de rétribuer les agriculteurs – via le marché du carbone – en calculant à l’hectare ce qu’une culture ou une prairie fixe de carbone (ce qu’elle a toujours fait). C’est un moyen d’une part de faire gagner de l’argent aux propriétaires fonciers et aux accapareurs de terres, d’autre part de continuer les grandes cultures industrielles, sans pour autant d’effet sur le climat et la biodiversité, tout en minant la légitimité de nouvelles subventions de la PAC. Les mêmes gardent la main sur le magot. Il s’agit de ne rien changer sur le fond.
L’UE continue d’être injuste envers la plupart de ses paysans et ruraux, envers les consommateurs et envers ses partenaires commerciaux. L’essentiel des subventions agricoles va à des propriétaires terriens qui n’en ont pas besoin. L’alimentation est toujours plus transformée, moins saine et moins abordable. Les exportations subventionnées et le gaspillage alimentaire subsistent. Les grandes expositions agricoles et alimentaires, la Semaine Verte à Berlin et le Salon de l’Agriculture à Paris, reflètent la rigidité de l’industrie agricole et alimentaire qui s’en tient au business as usual. Les robots, les grosses machines, la food industry se présentent sous un maquillage de paysannerie idéalisée, laissant croire aux visiteurs des salons que les choses sont bien en place et sous contrôle. Aucun signe de changement du système agricole et alimentaire pour le rendre plus résilient et équitable.
N’attendant plus rien de Bruxelles, des agriculteurs, des consommateurs, des conseils municipaux s’emparent des questions agricoles et alimentaires et bâtissent des Politiques agricoles et alimentaires (PAAC) que nous répertorions dans l’ouvrage Rural Europe Takes Action. Ces expérimentations devraient être intégrées à la révision en cours des plans stratégiques nationaux agricoles et inspirer le nouveau cadre de réforme de la PAC annoncé par la Commission européenne pour la fin de l’année.
Cette tribune est apparue dans Le Monde dans l’édition du vendredi le 24 février 2023. Elle est publiée ici avec son aimable autorisation.
Après cet article
Extrait de livre | La politique agricole et alimentaire communale – PAAC – de Plessé
Un avenir à co-construire – Rencontre européenne ARC2020 en Loire-Atlantique
Pollinisation croisée des idées du Portugal : Nos Campagnes en Résilience à Plessé
Evènement | Un point d’étape sur les propositions campagnardes
Enjeux de transition | La transmission, ou le trait d’union entre les générations
4 constats forts de la rencontre européenne « Nos campagnes en résilience »
Enjeux de transition | Face à la guerre foncière, garder les pieds sur terre